

Une composition d'Histoire
projet de développement rédigé
PORTAIL TERMINALES
MEDIATEGIA
 |
|
 Une composition d'Histoire projet de développement rédigé |
|
| reculer d'une page PORTAIL TERMINALES |
Les Etats-Unis : de l'Hyperpuissance au Monde Bipolaire
|
revenir à l'accueil : clic ci-dessus
MEDIATEGIA |
L'Amérique entre tensions et intégrations
Introduction
L'Amérique, cet immense continent qui s'étire du Nord au Sud du globe, de
l'Océan glacial Arctique à l'Antarctique, se caractérise par une très grande
diversité géographique, socioculturelle et économique. On y retrouve trois
ensembles géographiques: l'Amérique du Nord, regroupant le Canada, les
Etats-Unis et le Mexique, l'Amérique centrale puis, l'Amérique du sud de Panama
à la Terre de feu. Ce « nouveau monde » reste fortement marqué par la
colonisation européenne, qui a divisé ce continent en deux grands blocs :
l'Amérique anglo-saxonne (le Canada et les Etats- Unis) et l'Amérique dite
« latine » au sud du Rio Grande. Dans quelle mesure ce continent est-il partagé aujourd’hui encore entre
fragmentation et volonté d'unité ?
Problématique
(Qui, des Etats-Unis ou
bien du Brésil, a le plus d’atouts pour profiter de l’achèvement probable du
processus d’unification continentale amorcé dans le cadre de la mondialisation ?)
Annonce du plan
S'ils connaissent de fortes tensions à
toutes les échelles, les Etats américains tentent depuis
des décennies de se regrouper, mais ils constituent
traditionnellement la « chasse gardée »
des Etats-Unis, première
puissance mondiale.
Aujourd'hui, plus
encore que dans le passé, les ambitions hégémoniques des Etats-Unis se heurtent
pourtant à de nombreuses résistances de la part de leurs voisins, sans que
l’intégration économique du continent soit pourtant perdue de vue par les différents
acteurs politiques.
Développement
Ce continent a d’abord
été marqué par la colonisation européenne. Dès le XVIe siècle, les Espagnols
sont présents du Mexique à la Patagonie, les Portugais au Brésil et les
Anglo-Saxons au Canada et aux Etats-Unis.
Cette conquête met fin aux empires précolombiens et
reste une tragédie pour les populations amérindiennes qui furent décimées («
les veines ouvertes de l'Amérique Latine » de l'uruguayen Eduardo GALEANO). La
traite de millions d'esclaves noirs marque ensuite les territoires brésilien,
caribéen et étasunien. Les flux massifs de migrants européens contribuent au
peuplement. Aucun autre continent n'a connu une colonisation de peuplement
d'une telle ampleur et cela a contribué à l'insertion de l'Amérique dans un
processus de mondialisation dès l’ère pré-industrielle. La conquête a abouti à
la fois à des ressentiments profonds entre communautés et à une césure entre
deux Amériques : l'anglo-saxonne protestante au nord et l'Amérique Latine
catholique au sud. Mais le métissage reste une composante forte de ce continent
et le multiculturalisme reste prégnant.
Les indépendances aboutissent à l'éviction des états européens mais si le «
nouveau monde » façonne son identité contre le « vieux continent » il s’inspire
de ses modèles politiques (la Révolution française, notamment) et subit
l’influence des Etats-Unis, qui ont proclamé leur indépendance dès 1776 et se
retrouvent en position de force face à leurs voisins divisés. Si les pays sud
américains se libèrent de l’emprise espagnole au début du XIXème siècle, ils se
divisent, contrairement au rêve de Bolivar qui souhaitait l'unité.
La mise en place de la doctrine
Monroe, dès 1823, inaugure la politique de « l'Amérique aux américains ».
Cela se concrétise, par exemple, par l'expulsion des Espagnols de Porto Rico en
1898. L'Amérique centrale et les Caraïbes deviennent l'arrière cour des EU avec
des interventions militaires directes comme à Haïti de 1915 à 1934, en Colombie
en 1903 créant de toutes pièces la république de Panama. Les rapports de
domination nourrissent en Amérique Latine un sentiment « anti-yankee ».
Longtemps sous la coupe des nord-américains, avec un gradient de dépendance
décroissant en fonction de l'éloignement (Mexique « si loin de Dieu, si près
des EU » selon la formule de Portfirio Diaz) l'Amérique latine prend
aujourd'hui ses distances. Si le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes
restent fortement liés à leur puissant voisin, le Brésil ou les pays du Cône
Sud ont acquis plus d'autonomie.
Les tensions sont évidemment fortes durant la guerre froide : dès 1947, Les
Etats-Unis créaient une alliance militaire de tous les états du continent ; en
1948, création de l'OEA (Organisation des Etats Américains) dont Cuba est
exclue au début des années soixante. Les Etats-Unis soutiennent les dictatures,
notamment au Brésil, au Chili, ou Argentine et interviennent à chaque fois que
leurs intérêts sont menacés comme au Nicaragua contre les Sandinistes ou à
Grenade en 1983.
Bien qu'en recul aujourd'hui cette tutelle militaro-économique
conserve les formes d'un
interventionnisme diffus, relayé par une influence multiforme :
investissements financiers, lutte contre les narcotrafiquants en
Colombie et au Mexique. Pour Washington,
« l’hémisphère occidental »
doit être contrôlé, cela relève de sa
« sécurité nationale ».
Si les Etats-Unis ont plus de difficultés à affirmer
leur domination exclusive , leur poids reste essentiel avec 77% du PNB
continental. Leur omniprésence est
d’ordre économique : rôle des FTN comme Chiquita qui emploie plus de 14 000
personnes en Amérique centrale ou Monsanto qui impose les OGM en Argentine ou
au Paraguay. Cela alimente une dénonciation de l'impérialisme américain dans
tout le continent. Les gouvernements de pays émergents comme le Brésil, mais aussi Cuba et le
Venezuela du défunt président Hugo Chavez, ou la Bolivie d'Evo Morales, sont ouvertement hostiles au
modèle économique du puissant voisin du Nord.
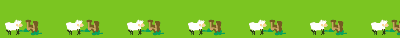
2 / CLIVAGES
Au plan politique, des conflits régionaux ont
laissé des traces, entre les états latino-américains, comme (entre
autres) la guerre du Pacifique de 1879 à 1883, perdue par le Pérou et la
Bolivie contre le Chili et nourrissant des contestations frontalières encore
vives aujourd'hui.
Les fractures spatiales restent fortes, en Amérique centrale et du Sud, entre les espaces intégrés à la mondialisation
(littoral, métropoles, CBD...) et les périphéries délaissées (intérieur des
continents, espace rural, périphéries urbaines informelles comme les favelas au
Brésil...).
La recherche par les gouvernements d'une intégration d’espaces peu peuplés mais
vastes et périphériques, soit pour affirmer la souveraineté nationale ou encore
pour s’approprier des ressources stratégiques comme dans le cas des fronts
pionniers (Amazonie, Chaco, grand Nord..) est source de divergences ou d'affrontements entre les
Etats et les « ethnies autochtones » revendiquant la
reconnaissance de leurs droits ancestraux et la gestion durable des ressources (comme
en Patagonie, en Amazonie).
Les revendications des peuples indigènes
spoliés demeurent un problème au Nord comme au Sud du continent (celles
des Inuits au Canada ou des Mapuches au Chili et en Argentine restent latentes)
et les Etat s du Sud n’y répondent pas forcément partout avec la même
sollicitude que le Canada – encore que la solution trouvée fasse l’objet de
critiques.
L'enclavement et le retard économique de certaines régions comme les hauts
plateaux d'Amérique centrale, la forêt dense d'Amazonie, ont favorisé le développement des guérillas
souvent issues de rebellions paysannes comme les FARC en Colombie. Celles-ci
sont, aujourd'hui, souvent liées aux activités illicites, notamment les trafics
de drogue, et leur existence justifie paradoxalement des interventions
militaires étatsuniennes (au Mexique ou en Colombie notamment).
Il existe de nombreux
conflits internes qui se manifestent par une violence généralisée, liée aux
inégalités sociales et à l’agressivité des criminels, sensible tant dans les
campagnes (Chiapas) que dans les villes, comme au Brésil ou en Colombie (cartels).
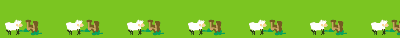
3 / UNIFICATION ECONOMIQUE INACHEVEE, FAIBLE COHESION POLITIQUE
Au Nord, on observe une
forte intégration régionale dominée par les Etats-Unis : c'est l'ALENA (ou NAFTA)
Ce système regroupe depuis 1994 le Canada, Les Etats-Unis et le Mexique, c'est-à-dire
460 millions de personnes sur 21,5 millions de Km². L'association représente sans doute la
première aire de puissance de la planète (comparable à l’UE). Son RNB de 17000
milliards de $ en 2010 représente un quart des richesses produites dans le
monde. Elle organise la libre circulation des capitaux, des marchandises mais
pas des personnes. Les entreprise anglo-saxonnes investissent massivement
au Mexique (maquilladoras) sans enrayer pour autant l'immigration mexicaine (mais
aussi centre et sud-américaine) jugée parfois indésirable aujourd’hui, qui reste
forte (wet backs). C’est Ottawa qui, au départ, a exigé l’association des trois
états d’Amérique du Nord pour ne pas rester seul face à face avec les
Etats-Unis !
Le cœur du processus d'intégration
est les Etats-Unis qui attirent 75% des
exportations canadiennes et 78% des exportations mexicaines. De puissantes
régions transfrontalières émergent comme la Mexamérique ou la Main Street le
long du fleuve St Laurent.
L'ALENA est un agreement,
c'est-à-dire un accord intergouvernemental, procédure
choisie par la Maison Blanche pour éviter toute obstruction du
Congrès à la signature d'un traité en bonne et due
forme.
Au
Centre et au Sud, les
systèmes d'intégration régionale sont nombreux,
tous en opposition plus ou moins franche aux Etats-Unis
Les organisations internationales visent à la constitution d'ensembles régionaux à multiples participants,
mais aussi, à la réalisation de grands projets structurants. Cependant, ces associations
locales sont trop nombreuses pour être efficaces (disparités entre états
membres, superposition des unions...). La fragmentation politique en Amérique
centrale y perpétue l'emprise étatsunienne. Malgré la création du Marché Commun
Centre Américain (MCCA) et la Communauté des Caraïbes(CARICOM), ces pays restent
fragiles et montrent une dépendance forte dans le secteur agricole ou
touristique notamment.
Le Brésil, au premier rang parmi les puissances
émergentes, est devenu l'acteur
décisif des processus d'intégration, beaucoup plus
accomplie au Sud qu'au Centre. Le MERCOSUR, créé en 1991,
s'est élargi par la suite. Les cinq pays
fondateurs représentent 273 millions d'habitants sur plus de
12,7 millions de Km2. Le
MERCOSUR est une réussite mais cette zone de libre
échange, qui est aussi une Union douanière,
semble profiter surtout au Brésil.
La volonté d'intégration à l'échelle de
l'Amérique latine tout entière a débouché
sur un rapprochement
entre le Mercosur et la CAN (Communauté Andine des Nations) et a
abouti à la
création dès 2004 de la Communauté Sud
Américaine des Nations qui est devenue
en 2008 l'UNASUR (Union des Nations Sud Américaines)
fondée à Brasilia. Cette
alliance favorise la construction d'infrastructures pour connecter les
territoires comme l'aménagement du bassin du Paraná ou la
construction d'un
gazoduc entre le Venezuela et l'Argentine. Elle aurait à terme
vocation à chapeauter le MERCOSUR puis à s'y substituer,
en ayant pour modèle l'Union Européenne.
Le Venezuela, pour contrer la ZLEA, a impulsé en 2005 l'ALBA (Alternative
Bolivarienne pour les Amériques) renommée L'Alliance Bolivarienne des peuples
d'Amérique. Plus d’une dizaine d’états d’Amérique du Centre et du Sud en font
partie, dont Cuba.. Citons pour finir la CELAC (Communauté des Etats Latino Américains et
des Caraïbes), créée en 2011, qui reste un simple forum culturel et politique pour un
développement du bloc latino- américain.
A l'échelle continentale, une intégration en
panne ?
Aujourd'hui, l'Organisation des Etats Américains (OEA) végète, et surtout la Zone de Libre
Echange Américaine(ZLEA), lancée par les Etats-Unis en 1994, reste lettre morte,
notamment du fait de l'hostilité de nombreux états latino-américains comme le
Brésil ou l'Equateur, qui ont négocié et obtenu un accord « à la
carte » préservant leur liberté d’ouvrir ou non leurs frontières aux
importations.
L'ambition de Washington de construire une union continentale forte
a donc échoué, cet effort étant compris comme une velléité impérialiste.
L’intégration productive est pourtant une
réalité. En effet,
sous la pression des institutions internationales (FMI ou OMC), les
états abaissent
ou suppriment progressivement leurs tarifs protecteurs et les relations
commerciales avec
les Etats-Unis se renforcent (par exemple : au Venezuela, les EU
restent
le 1er client et fournisseur). Les réseaux sont cependant mal
connectés, et
même s'il existe des ponts transcontinentaux Est/Ouest, un
seul axe
routier relie les territoires du nord au sud : la route
panaméricaine. Les flux
migratoires témoignent toutefois de l'importance des contacts
entre pays du
continent. Ils restent les plus importants du monde (au sein de
l'Amérique
latine ou entre l'Amérique latine et l'ensemble EU/Canada). Cela
aboutit notamment à un
brassage culturel et à des sociétés
pluriethniques. L’Espagnol est la seconde
langue parlée aux Etats-Unis - peut-être bientôt la
première ? et il est enseigné au Brésil tandis que
le Portugais
l’est dans les pays hispanisants.
Conclusion
Le bilan de l'intégration
continentale des Amériques apparaît mitigé car ses
réussites n'ont pas permis d'apaiser toutes
les tensions politiques et restent aujourd'hui, essentiellement, des
succès économiques.
Contrairement à l'intégration européenne, le
processus d’unification
interaméricain semble encore balbutiant,
et les conflits et contrastes économiques demeurent
extrêmement forts
dans cette aire, que de trop nombreuses mais trop faibles institutions
régionales concurrentes prétendent vouloir regrouper.
Le leadership des
Etats-Unis est d’autant plus contesté que c’est ce pays qui semble parfois
s’opposer à l’intégration sans exclusive de ses voisins (le problème de
l’embargo frappant Cuba est loin d’être réglé malgré quelques initiatives
récentes prises en ce sens par le Président Obama). L’influence croissante du
Brésil, puissance ascendante et membre éminent du groupe des BRICS, n’est pas
par ailleurs sans froisser la susceptibilité des pays de langue espagnole (notamment
l’Argentine) malgré des traits
culturels communs. Pour l'instant, unapprofondissement de
l'intégrattion continentale dépendrait d'un effort de
coopération entre les Etats-Unis et le Brésil, or les
deux puissances sont rivales, le Brésil aspirant sans doute
à prendre un jour le leadership continental : on en est
encore loin !
La situation de l'Amérique n'est-elle pas au fond comparable à celle d'autres aires
continentales, qui, telle l'Asie de l'Est, connaissent bien souvent
une intégration économique croissante, mais sont empêchées de
renforcer leur cohésion politique par des disputes récurrentes entre puissances régionales ?