1. Le retour sur la méthode
En
principe, l'analyse documentaire (quand elle porte sur un seul
document) doit permettre d'atteindre deux grands objectifs essentiels :
mettre en évidence l'information principale du document et replacer le document dans son contexte (et par là, dans l'idéal, expliquer le contenu du document en le reliant à son époque).
|
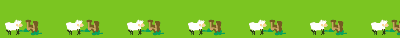
L'INFORMATION PRINCIPALE
Il ne faut pas se contenter de décortiquer le document en repérant les informations qu'il contient, il faut encore les hiérarchiser.
Donc : choisir celle des informations qui est la plus importante.
Pour élire cette information essentielle, il faut s'appuyer
moins sur son libre arbitre (puisque le format de l'épreuve ne
vous donne guère le loisir d'argumenter) que sur des
connaissances et des références scolaires ou culturelles
: le programme et le cours définissent implicitement les
principaux mouvements et faits à distinguer dans la
période contemporaine (la phase 1850-2000, objet de votre
étude en première S).
LE CONTEXTE
Il ne faut pas oublier de situer l'ensemble des données dans le "Siècle"
étudié, et faire référence explicitement
à l'Industrialisation et à la Modernisation, à
leurs aspects les plus évidents dans le document.
Ce serait une erreur d'éluder toute allusion au "temps long" :
nombre d'élèves escamotent cette étape essentielle
dans leur exposé !
L'idéal est de mettre en rapport le fait qu'illustre le document
avec un ou des événements, ou, quand il s'agit d'un
document montrant une évolution, de périodiser celle-ci.
|
2. La phase d'analyse proprement dite
En
fait, il s'agit de "lire" le document, d'en comprendre le
sens. Se
reporter au titre est vital : ici, c'est le "monde du travail"
qui est au
centre de l'intérêt. Il faut donc voir ce qui, dans
le tableau,
permet d'en apprécier l'évolution depuis 1850
jusqu'à nos jours : le nombre des actifs, la composition
de la population active.... et se demander d'emblée si des
ruptures chronologiques facilement explicables s'observent .
La formulation du sujet permet de comprendre - si on ne la sait pas
- ce qu'est la population active : il s'agit des "travailleurs"
(ceux et celles qui sont en situation d'exercer un emploi
rémunéré).
Tout élève bien préparé s'attend à
pouvoir démontrer grâce au document le passage d'une
économie (et d'une société) rurale à une
économie urbaine, industrielle puis post-industrielle.
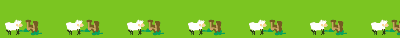 |
LES DONNEES
1.On observe que l'Agriculture est un secteur numériquement en
déclin, sur toute la période. Majoritaires en 1850,
représentant encore près du tiers des actifs dans les
années 1950, les agriculteurs constituent ensuite un secteur
marginal, voire résiduel en 2008.
2.Les emplois dans l'Industrie augment sans cesse en proportion
jusqu'aux années Trente, mais se stabilisent ensuite
puis commencent à décliner àprès 1975, tout
en représentant encore un quart du total des postes
ocuupés (stabilisation depuis les années 90).
3.Les services se développent d'abord lentement, de 1852
à 1930, puis "décollent". Les emplois du secteur
représentent la majorité dès 1975, puis
représentent presque les 2/3 du total des emplois
(71,9 % en 1999 et 2008).
4. La population active augmente nettement moins vite que la population
totale (car les individus en âge de travailler ne sont pas les
mêmes en fonction des évolutions de la législation
et des moeurs : plus d'actifs sont recensés en 1930 qu'en 1954
!).
5. Le chômage n'est pas mesuré précisément
en 1850 et 1906, il est faible en 1954 et encore en 1975, atteint un
pic ensuite, à plus de 10% en 1999, et semble contenu - mais
à un niveau élevé - en 2008.
LE LIEN AVEC LE CONTEXTE
L'Industrialisation se déroule en trois ou quatre
révolutions qui précipitent le déclin de
l'artisanat et de l'agriculture comme secteurs pourvoyeurs d'emplois.
Le fait marquant, entre 1850 et 1930, c'est l'expansion de la
production industrielle et l'explosion du nombre des ouvriers, dans les
pays les plus modernes, dont la France fait en effet partie (des
découvertes sont appliquées à la production :
sidérurgie et aluminium, électricité, automobile,
aviation). On
constate bel et bien que le "pourcentage d'ouvriers"
atteint son maximum en 1930 dans le
tableau .
La Grande Dépression consécutive au krach de 1929 et la
difficile reconstruction, au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale, semblent se traduire par une stabilisation des effectifs
industriels. En fait, ils se maintiennent au dessus du tiers des
effectifs totaux durant toute la période dite des
"Trente Glorieuses" mais diminuent sensiblement ensuite.
C'est la Révolution des technologies, qui s'amorce
dès les années Trente et explose véritablement
après 1975 ; elle renforce le poids d'un secteur tertiaire
gonflé par le développement de la grande
distribution, du tourisme et des loisirs, la féminisation de la
main d'oeuvre, l'externalisation des tâches. La
désindustrialisation relative du pays ces quarante
dernières années accentue encore la tendance.
|
3. La phase de réflexion
Avant de se lancer dans la rédaction, il convient de se demander
quel est le message principal contenu dans le document, et de bien appréhender la consigne.
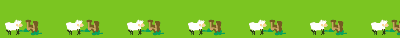
Après 1930, les Services connaissent une
extraordinaire embellie et l'Industrie confirme son importance, mais
les effectifs dans l'Agriculture s'étiolent : on entre peu
à peu, après la Dépression et la Seconde Guerre
Mondiale, dans l'ère de la société de consommation
et de l'exode rural massif (le mouvement devient spectaculaire dans les
années Cinquante).
Les seconde et la troisième révolutions indutrielles
(mutations scientifique puis technologique) peuvent donc être
repérées d'après le tableau.
A la fin de la période, le chômage devenu endémique
et l'esssouflement de l'emploi industriel semblent annoncer une
prochaine mutation (liée à l'essor récent
des TIC et à l'émergence d'une société de communication ?)
|
L'ESSOR DE L'EMPLOI INDUSTRIEL... PUIS SON RECUL
Comme on peut le vérifier d'après les supports
montrés dans le Manuel (p 46, ici à gauche et p 48,
ci-dessous) la proportion des
effectifs occupés dans l'Industrie est la donnée la plus
facile à utiliser et commenter et, de ce point de vue, deux
phases sont à distinguer. Dans la première,
l'emploi dans l'Industrie ne cesse de se développer aux
dépens des autres secteurs. Dans la seconde, l'Industrie est
dépassée par les Services (et l'Agriculture
s'effondre).
Jusqu'en 1930 : l'Agriculture se tasse mais demeure un secteur
important, l'Industrie progresse notablement et
régulièrement, les services gagnent très
légèrement en importance. C'est que la modernisation de
l'économie et de la société ne fait que commencer
: les campagnes ne se vident pas mais exportent vers les villes leur
excédent naturel, les paysans sont aussi nombreux que les
ouvriers, les classes moyennes commencent tout juste à
s'étoffer, le salariat féminin demeure une réalité d'ampleur limitée.
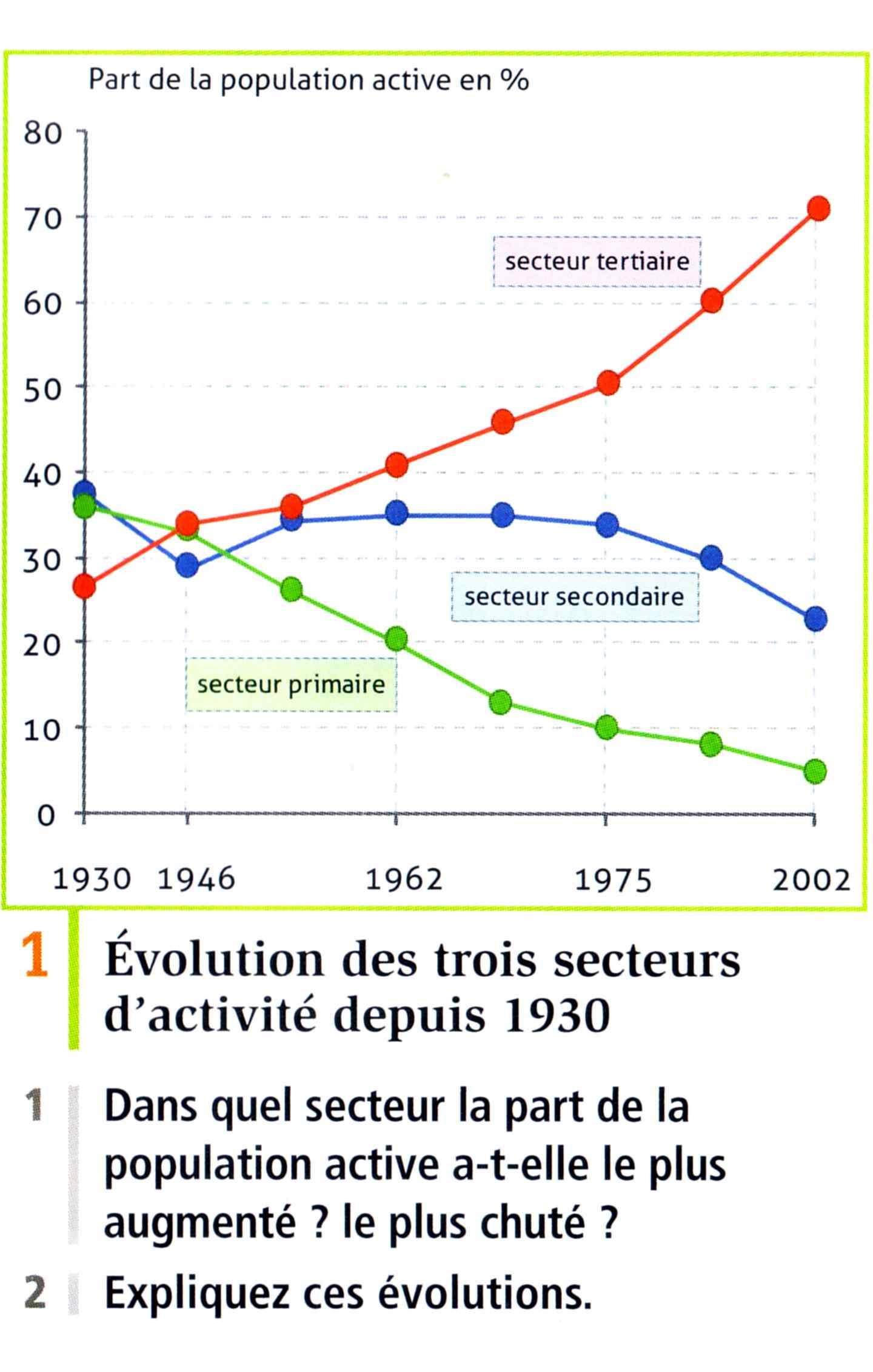 LA CONSIGNE
LA CONSIGNE
Elle commande de développer une présentation
fouillée (nature, source, contexte) puis indique la
nécessité d'éclairer le support mais aussi - implicitement - de critiquer le document (puisque ce dernier ne "révèle" pas toutes les "évolutions").
|
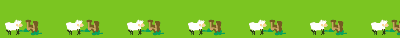
La rédaction
On doit veiller à bien répondre à la question posée :
*être clair sur la nature et la valeur du document (PRESENTATION)
* dégager les phases dans le mouvement de la population active (DEVELOPPEMENT)
*indiquer rapidement les limites du support (CRITIQUE)
Il faut bien sûr essayer d'avoir une syntaxe appropriée
mais, dans ce type d'exercice (un quart de la note globale au
Baccalauréat) on n'attend pas forcément de grandes
qualités littéraires .
Notation : Il ne s'agit pas pour le correcteur de bâtir un devoir
idéal par rapport auquel l'élève sera noté.
Toute initiative judicieuse sera valorisée et, de facto,
toute restitution de connaissance... parfois même, quand
elles ne sont pas en rapport direct avec la question posée, ce
qui est contestable !
Connaître les notions de secteur primaire, secondaire et
tertiaire et les utiliser convenablement serait sans doute un "plus"
appréciable, de même vous pourriez avec raison
déplorer l'absence d'indicateurs sociologiques tels que le % de
bacheliers (allongement des études,
élévation de la qualification) qui pourraient illustrer
les progrès sociaux mais expliqueraient partiellement la
stabilisation du nombre des actifs. D'autres bonifications sont
envisageables si des exemples sont cités à propos
(par exemple, celui d'André Citroën comme industriel
précurseur de la seconde révolution industrielle, de la
réclame et du "Fordisme" importés des Etats-unis).
Attention : la notion de 3ème Révolution Industrielle ne
fait pas consensus ; précisez quelle acception vous validez.
à chaque fois que vous utilisez la formule. |
Proposition d'introduction (barème : environ 3 points sur 10).
Le tableau porté à notre attention
montre l'évolution de cinq données concernant le
monde du travail en France depuis 1850 (moment du décollage de
la Seconde Révolution Industrielle ou "mutation scientifique"
dans laquelle l'Europe occidentale joue un rôle
décisif) jusqu'à nos jours. Les données ont
été compilées par l'INSEE, organisme officiel qui,
depuis sa création en 1945, collecte
et publie les informations statistiques de l'économie
française, aujourd'hui encore l'une des plus
développées au monde malgré un contexte de vive
concurrence internationale qui fragilise les anciens pays
industrialisés, confrontés aux ambitions des nations
émergentes. On dénote la part de chacun des grands
secteurs d'activité dans l'emploi national, le nombre des actifs
et le taux de chômage, lequel est resté
élevé depuis une quarantaine d'années, donnant le
sentiment d'une "crise" de longue durée.
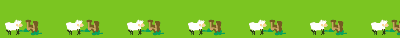
Proposition d'analyse (barème : environ 6 points sur 10).
Pour éviter une très longue paraphrase
(proche de celle de notre analyse, dans le paragraphe intitulé "les données") laquelle, malgré sa
lourdeur, ne pourrait suffire à traiter complètement la
consigne (car elle devrait ensuite être reliée au
contexte) il serait plus efficace de s'inspirer du texte contenu dans notre
partie 3, "La phase de réflexion" qui décrit les évolutions en les
contextualisant... mais on y ajouterait quelques citations
(telle donnée, telle valeur, telle année) voire des
explications (par exemple sur l'externalisation des tâches qui
dégonfle automatiquement les emplois dans l'Industrie) ; de
cette
manière on éviterait de recopier le document tout en
traitant complètement la consigne.
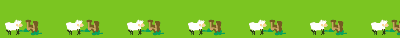
Proposition de conclusion (barème 1 point sur 10).
Les informations de l'INSEE sont reconnues comme
très fiables,
mais il est facile de montrer au moins l''une des limites du support.
Par exemple, le fait qu'il nous renseigne sur la situation à
sept dates, et non en continu. Ou bien que des informations
statistiques manquent aux dates les plus anciennes, ou encore que les
indicateurs sont
parfois contestés, tant il est vrai que la définition du
chômage ou des secteurs d'activité est sujette à
caution. L'appel de main d'oeuvre dans l'Industrie est visible,
pas ses conséquences principales (taux d'activité des
femmes en augmentation, immigration de travail). |
